Tout être humain vit d'espérance
Il coraggio e la paura 19.04.2025 Vito Mancuso Traduit par: Jpic-jp.orgLe pape François a fait des « Pèlerins de l'espérance » le slogan de l'année jubilaire ; pour les catholiques, l'espérance est une vertu théologale, ce qui donne la fausse impression qu'elle n'est attribuable qu'aux chrétiens ; en réalité, tout être humain « en a une et vit de l'espérance ». Le point de vue d'un philosophe.

Tout être humain « en a une et en vit », étant donné que nous sommes nos désirs et que la somme des désirs constitue le but vers lequel nous tendons, ce que l'on peut appeler l'espérance ; mais ce qui fait de cette espérance une vertu, c'est l'espérance dans le bien, dans la possibilité d'un changement réel en faveur d'une plus grande justice. C'est également à ce niveau que se mesure la valeur d'un être humain et de sa pensée.
Ce n'est pas par hasard que Kant a placé l'espérance parmi les trois objets par excellence de la pensée, avec la connaissance et l'éthique, comme on peut le lire dans un passage de la Critique de la raison pure où il présente les trois questions fondamentales que tout être humain devrait se poser : « Tout intérêt de ma raison (tant spéculative que pratique) se concentre dans les trois questions suivantes : 1-. Que puis-je savoir ? ; 2-. Que dois-je faire ? 3-. Que puis-je espérer ? » L'utilisation de la première personne du singulier indique qu'il ne s'agit pas ici de dissertations académiques, mais d'une existence concrète, ici et maintenant, à la recherche d'un sens pour lequel et par lequel vivre. Plus tard, Kant a reformulé cette pensée comme suit : « Le domaine de la philosophie peut être ramené aux problèmes suivants : 1-. Que puis-je savoir ? 2-. Que dois-je faire ? 3-. Que puis-je espérer ? 4-. Qu'est-ce que la personne ? La première question trouve sa réponse dans la métaphysique, la deuxième dans la morale, la troisième dans la religion et la quatrième dans l'anthropologie. Mais, en fin de compte, toute cette matière pourrait être attribuée à l'anthropologie, car les trois premières questions se rapportent à la quatrième.
Il s'agit donc en fin de compte d'anthropologie, non pas en tant que discipline académique, mais en tant que question existentielle que la situation limite pose ici et maintenant à la conscience de chacun : toi, quel être humain es-tu ? Notre identité n'est pas statique mais dynamique, c'est-à-dire déterminée par la nébuleuse de besoins-désirs-aspirations qui appellent notre chaos intérieur et lui donnent une direction et une forme. Notre véritable identité est donnée par notre espérance. Alors, quand un être humain change-t-il ?
Un être humain change lorsque changent ses désirs, dont la somme s'appelle l'espoir, qui, au lieu de tendre vers des besoins, s'élèvent et deviennent des aspirations, de sorte que, au lieu de ressentir le désir irrépressible d'une énième paire de chaussures ou d'un sac ou d'une chemise, ou d'une position ou d'une reconnaissance ou d'applaudissements, il commence à ressentir le désir de moins de chaussures, moins de sacs, moins de chemises, moins de positions, moins de reconnaissance, moins d'applaudissements, moins de tout, juste de choses vraies, s'il vous plaît, juste de choses vraies et de personnes vraies, s'il vous plaît : de la vraie musique, de vraies pages, de vrais amis, de vraies relations. D’une vie vraie.
J'ai lu quelque part que selon Isidore de Séville, érudit du sixième siècle et expert en étymologies, le mot espoir, en latin spes, vient de pes, pied ; fondée ou non, l'étymologie est suggestive : l'espoir est ce qui fait que l'on marche dans la vie. Sans espoir, on ne marche pas. Une célèbre page d'Eschyle sur Prométhée, le titan qui a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes, le confirme. Alors qu'il est enchaîné sur une montagne du Caucase par ordre de Zeus, avec un aigle qui le jour mange son foie qui repousse la nuit, une coryphée lui demande la raison de son état et Prométhée lui répond qu'il a été puni pour avoir eu pitié des êtres humains : « Les hommes ont toujours eu, fixée devant les yeux, la mort : j'ai fait cesser ce regard ». La coryphée lui demande : « Et quel remède as-tu trouvé à ce mal ? ». Réponse : « J'ai fait habiter en eux l’aveugle espérance ». Ce n'est qu'à ce moment que Prométhée ajoute : « Et puis je leur ai procuré du feu ».
Avant de donner le feu aux hommes, Prométhée leur a donné l'espérance, qu’il qualifie d'aveugle non pas parce qu’elle est fatuité, mais par définition : l'espérance, en effet, ne voit pas comment tout va se terminer. Elle est aveugle, mais elle est forte et donne de la force, au point que l'utilisation même du feu exige sa présence en raison de la confiance que l'œuvre sera fructueuse.
L'espérance a toujours été liée à l'essence de l'humanité, comme l'enseignent Eschyle, Kant et les traditions spirituelles. L'espoir et le feu, la confiance et la technologie, la sagesse et la science, doivent à nouveau être étroitement liés dans la société et, avant cela, dans l'existence de chacun d'entre nous.
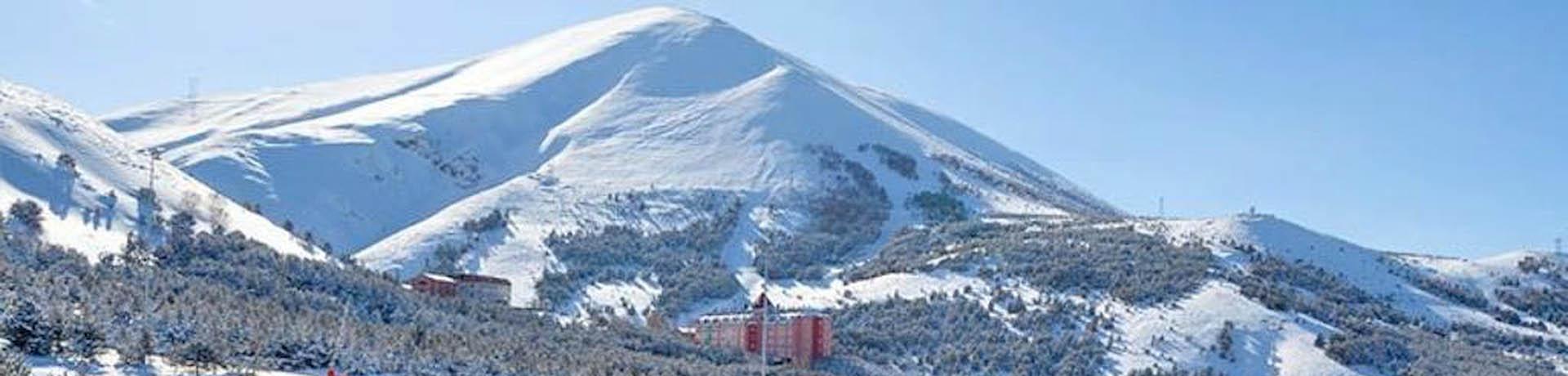






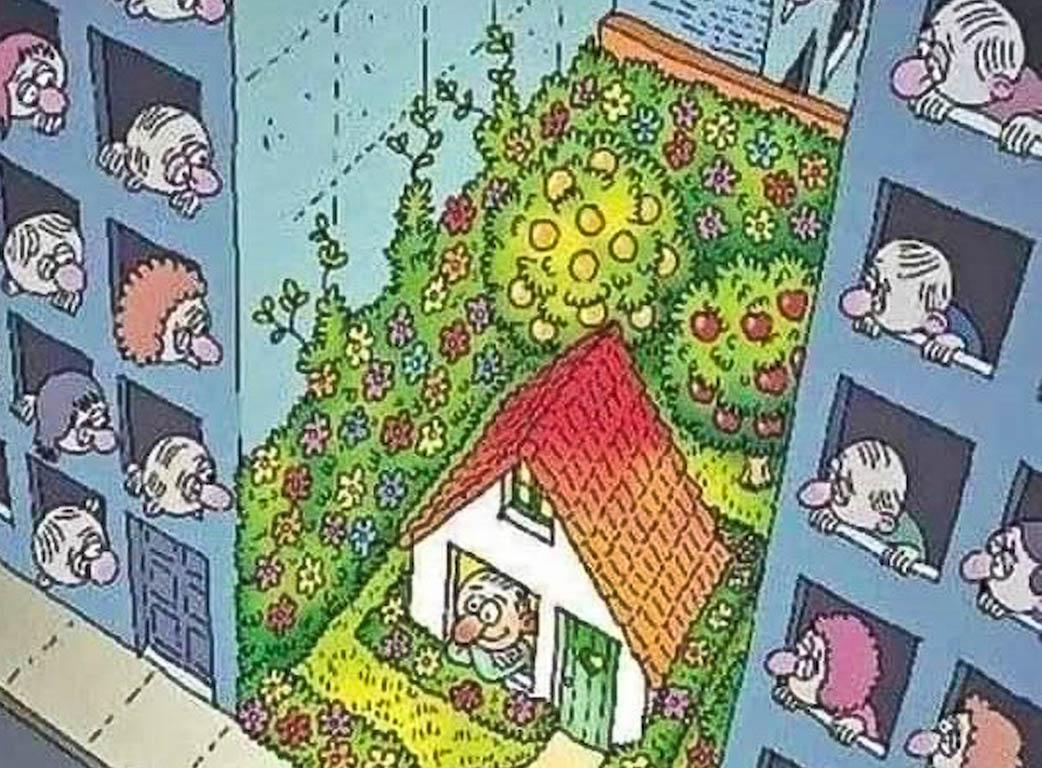
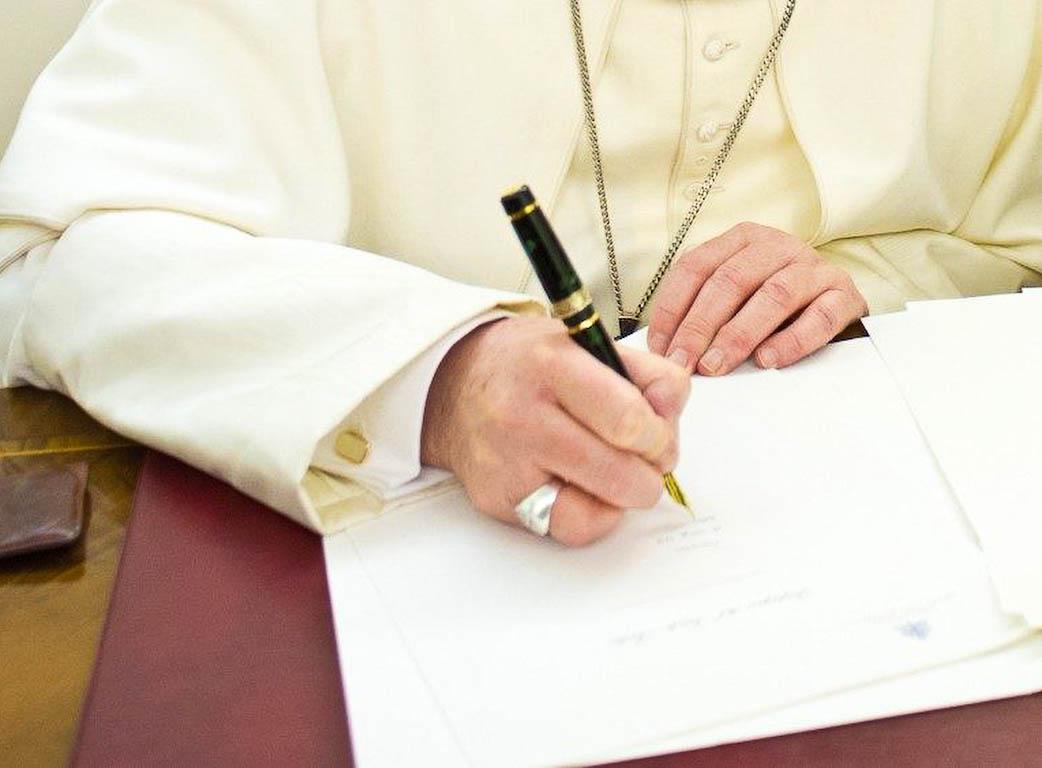






 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Laisser un commentaire