L'étoile de Noël
Racconti e leggende 24.12.2024 Paul Roland Traduit par: Jpic-jp.orgDe tous les mineurs du Griqualand, dans l’Afrique du Sud, Pierre Valaur était le seul qui ne célébrait pas joyeusement cette soirée du 24 décembre 1875. Hors de l’enceinte du camp, les Cafres – de l'arabe kaffir (infidèle), le nom désobligeant donné par les arabes aux africains - avaient allumé de grands feux autour desquels ils dansaient aux sons d’un fantaisiste orchestre. Dans la salle de l’unique auberge, éclairée pour la circonstance par de grosses lanternes en papier, pendues à un gigantesque arbre de Noël, les chercheurs de diamants faisaient un grand bruit.

Dans sa hutte misérable, Pierre Valaur passait le plus triste réveillon qu’il eût jamais connu.
Français et orphelin, s’étant un jour trouvé héritier d’une dizaine de mille francs laissés par une lointaine parente, il s’était laissé attirer vers ce coin de l’Afrique où la découverte de mines de diamants courait sur la bouche de tous.
Pierre avait vingt-sept ans, de l’énergie : il avait résolu d’employer son modeste pécule à l’achat d’un lambeau de cette terre des diamants, où un fermier boer du nom de O’Reilly avait, le premier, trouvé une de ces pierres précieuses vendue au prix fantastique d’un million trois cent soixante-quinze mille francs.
« Qui sait, se disait-il, si je n’aurai pas la même chance ! »
Il partit… Son voyage payé, il lui resta la somme strictement nécessaire à l’acquisition d’un très petit terrain et du matériel d’exploitation. Plein d’espoir, il se mit au travail ; sobre, tenace, âpre à la besogne, il devait réussir, si, dans ces sortes d’aventures, le hasard ne jouait pas un si grand rôle ! Hélas ! Après trois ans de labeur continuel, Pierre se trouvait plus pauvre qu’à son arrivée dans l’Afrique australe. Alors que beaucoup de ses compagnons s’enrichissaient, lui ne retirait de sa terre que des diamants d’un poids infime, dont la vente ne lui permettait que de vivre dans ce pays où les objets de première nécessité avaient atteint une énorme valeur.
Quatre fois il changea de zone, espérant qu’ailleurs la terre serait plus productive : la mauvaise chance le poursuivait. Alors il faiblit, se laissa aller à l’angoisse, ne voulut plus végéter dans cet ingrat Griqualand, ni retourner en France où nul visage aimé ne lui sourirait. En cette nuit de Noël, se ressouvenant des joies douces de son enfance, pendant que ses compagnons se livraient à la fête, Pierre Valaur tomba dans le désespoir et résolut de se tuer, de quitter cette vie où rien ne le retenait plus.
Il sortit. La nuit était claire et tiède, une de ces belles nuits d’été africain où scintillent des milliers d’étoiles. Il passa devant l’alignement des huttes silencieuses, désertées par les mineurs qui, là-bas, dans la salle d’auberge, célébraient par des chants la fête de Noël.
Pierre se hâtait vers sa terre des diamants. C’est là que, pour braver le destin qui l’avait vaincu, il voulait se jeter du haut de sa mine, profonde de trente mètres.
Comme il arrivait auprès de la dernière cabane, une jolie voix d’enfant l’arrêta. Instinctivement, il se laissa distraire de son plan ténébreux, contourna un petit bouquet d’eucalyptus qui ombrageait l’habitation, et gagna un coin de terrain en friche au milieu duquel il vit une petite créature, mains jointes, tête haute.
« Bon père Noël, disait-elle, mettez cette nuit dans mon soulier, cette belle étoile que je vois là-haut, et je jouerai tous les jours avec elle ».
En entendant du bruit, la fillette s’était levée. Sans effroi, elle sourit au mineur qui lui demandait : « Qui es-tu ? »
« Laetitia Vasari, j’ai cinq ans, j’attends papa ». Pierre retint une exclamation. Le matin même, Andrea Vasari avait été tué par ses compagnons parce qu’il avait volé ; nul n’avait songé à l’orpheline, qui tenait une place si minime dans ce camp un peu sauvage qu’elle habitait depuis deux ans, et où elle vivait en solitaire, n’ayant plus de mère.
Après la mort de sa femme, Vasari, qui était un voleur de profession, pour échapper à la surveillance étroite de la police, était venu au Griqualand, dans l’espoir d’y amasser la fortune que ne lui avait pas procuré sa conduite déplorable. Ne voulant pas se séparer de sa fille qu’il chérissait, il l’emmena avec lui, et grâce à la sollicitude paternelle, Laetitia n’eut jamais à souffrir pendant son séjour dans le camp. Qu’allait-elle devenir à présent que son père était mort, victime de son inguérissable penchant au vol !
Pierre, songeur, regardait l’orpheline. Voyant qu’elle grelottait, que son visage était pâle, il ne voulut pas l’inquiéter et s’efforça de lui sourire, tandis qu’il lui prenait la main.
« Que demandais-tu donc au bonhomme Noël ? »
« Une étoile ».
« Une étoile ! - répéta-t-il surpris -, pour quoi faire ? »
« Pour jouer… oh ! Je ne la casserai pas, va, et quand il fera noir chez nous, elle m’éclairera. Tiens, là-haut, la vois-tu au bout de mon doigt ? C’est la plus belle ».
Le jeune homme enleva la fillette dans ses bras, la conduisit dans la maison, et la coucha dans son lit que la main du père n’avait pas arrangé le matin. Docile, elle but le thé chaud qu’il lui prépara, le remercia et le chargea d’aller chercher bien vite « son papa chéri ».
Il lui dit adieu et allait sortir, lorsque, remarquent le soulier, posé bien en évidence au seuil de la porte par où devait entrer le père Noël – il n’y avait pas de cheminée -, il expliqua, pour la préparer au chagrin du réveil :
« Ne compte pas sur ton étoile. Le ciel est trop haut pour que le vieux Bonhomme y monte la cueillir ».
« Tu crois ? - répondit-elle souriante - Eh bien ! Il prendra une échelle, je l’ai tant supplié ».
Il n’eut par le courage de détruire la confiance de cette enfant qui ignorait qu’une étoile n’est pas un clair et brillant diamant que le père Noël peut apporter en cadeau, mais un monde immense et lointain. Il la quitta et reprit sa marche hâtive vers la mort.
Le champ des diamants n’était pas sombre, car la nuit était superbe. Sans hésitation, sans regret, il marcha d’un pas ferme jusqu’à son domaine, délimité comme les autres par une clôture de piquets de bois. Il s’arrêta à l’extrême bord du creux de sa mine, croisa les bras et se dit froidement : « Ma vie n’est utile à personne, donc elle m’appartient. Nul ne souffrira de mon trépas », ajouta-t-il, songeant à Vasari qui laissait sa fille seule au monde.
Et cette fois encore, la triste condition de cette enfant, qu’hier encore il connaissait à peine, l’arracha à sa propre angoisse. Son cœur se serra, s’effraya à la pensée des souffrances que l’avenir réservait à Laetitia. La petite voix gazouilla à son oreille : « Il prendra une échelle… je l’ai tant supplié ! »
Il regarda le ciel. Oh ! Comme étincelait l’étoile que lui avait montrée la fillette. Il ne rêva pas longtemps ; d’un geste brusque se rejeta en arrière, loin du puits où il voulait se jeter.
« Attends quelques heures pour elle - se dit-il résolument -. Elle a si bien prié. Ah ! Si je pouvais mettre une étoile dans son soulier ! »
Il revint à la cabane de Vasari, écouta de la porte le souffle un peu précipité de l’orpheline, et revint à son logis. Les mineurs chantaient toujours, les feux des Cafres flambaient à travers les branches. Le jeune homme entra dans sa hutte déserte, alluma une lanterne, prit un lourd paquet de câbles, sa pioche, deux seaux de cuir, retourna au champ des diamants, et descendit à l’aide de cordages au fond de sa mine, où la mort l’avait guetté un instant auparavant.
Quand ses deux seaux furent pleins de terre, il les attacha aux cordes, remonta, hissa les seaux, et revint chez lui passer au tamis, à la seule lueur de sa lanterne, la terre maudite qui trompait toujours son espoir.
***
« Tiens, Valaur ! Voilà Pierre. Que lui est-il arrivé ? As-tu eu un peu de chance enfin ? Allons, viens chanter et boire avec nous ; tu es trop sobre, la fortune ne sourit qu’aux buveurs ».
Ces propos, motivés par l’irruption soudaine du Français, se croisaient dans la salle où les mineurs réveillonnaient. Le visage du jeune homme ne se détendit pas, les lèvres restèrent closes, il était pâle et agité. « Ce serait à croire - dit une voix narquoise -, que Valaur vient de trouver une fortune ».
« C’est précisément ça », articula à peine la voix de Pierre. Tous se levèrent d’un coup, s’approchèrent en parlant ensemble : « Où ? Quand ? Comment est-il gros ? Combien de carats ? »
Le jeune homme tira de sa poche un caillou brillant, d’un volume supérieur à celui d’une grosse noisette. Un formidable cri d’enthousiasme s’échappa de toutes les poitrines. Le diamant pesait au moins cent carats (vingt grammes). Il valait plus d’un demi-million.
Noël, le vin, les pipes étaient oubliées ; on assaillit de questions l’heureux possesseur du trésor ; l’espérance allumait d’une lueur leurs yeux : aujourd’hui c’était le Français, demain ce serait sans doute un autre qu’enrichirai cette terre tant fouillée par les pioches.
Sourd aux interrogations pressantes, Pierre s’entretenait avec Cornélius Brandt, le hollandais, qui exerçait au Griqualand le travail de lapidaire, de tailleur de diamants. Celui-ci, en caressant du doigt et du regard la pierre informe qu’il taillerait bientôt, écoutait les explications du jeune homme. Pierre narrait le fait en quelques mots. Ayant trouvé seule et prise de fièvre la fille d’André Vasari, il avait voulu tenter sa chance pour elle, et dans les seaux de terre rapportés du terrain, il avait recueilli ce diamant, don de Noël pour l’orpheline.
Quelques heures plus tard, le jeune homme sortait de chez le lapidaire, serrant dans sa main un diamant taillé, d’une valeur moindre que le sien, prêté sur sa demande par Cornélius qui gardait l’autre en gage.
Le reste de la nuit, assis au seuil de la porte entr’ouverte de Laetitia, il frotta le diamant avec un chiffon de laine, et quand, au matin, la fillette s’éveilla, il posa rapidement sur le bout du petit soulier qui attendait la visite du père Noël, le bijou brillant.
Le cœur battant, il épiait. Un cri d’extase ravie sortit de la couchette : « Mon étoile ! »
En deux bonds, Laetitia fut au soulier ; s’agenouillant pour prendre en sa petite main la pierre qui étincelait de toutes ces facettes, elle y mit un baiser, puis dit gentiment : « Tu t’es trompé, père Noël, l’autre était plus grosse ; mais c’est égal, celle-là brille autant ».
A travers les carreaux, Laetitia aperçut alors Pierre et lui fit signe d’entrer : « Tu vois qu’il a pris une échelle pour me cueillir mon étoile ».
Il baisa ce clair visage d’enfant, plein de joie, dont le souvenir là-bas près de la mine l’avait arraché à la mort, et les beaux yeux limpides lui parurent plus précieux que les plus gros diamants du monde. Il se dit alors que, bientôt, elle demanderait son père, qu’il la consolerait, la bercerait, l’appellerait sa fille, et l’existence leur semblerait bonne à tous deux ; elle était si petite encore et l’oubli est si facile à cet âge.
L’Etoile de Noël avait sauvé un homme et donné à l’enfant un père.
Voir, L'étoile de Noël












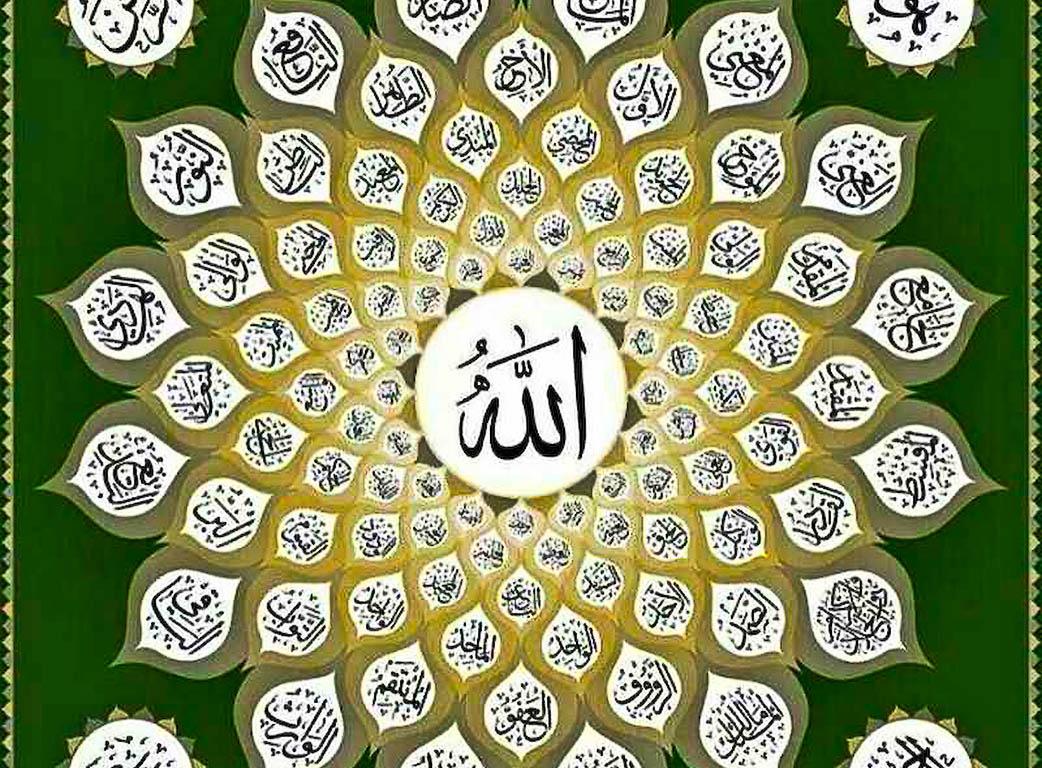








 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Laisser un commentaire