« Le victimisme est devenu une source d'autorité »
Ethic 11.04.2024 Ricardo Dudda Traduit par: Jpic-jp.orgLa philosophe américaine Susan Neiman, qui dirige l'Einstein Forum de Potsdam depuis 2000, vient de publier ‘Left is not woke’ (La gauche n’est pas woke - Debate, 2024), une défense de la gauche éclairée et une critique des ennemis de la raison. Plutôt que de critiquer le mouvement ‘woke’ - qu'elle refuse de définir car elle le juge incohérent - son livre défend certains aspects des Lumières qu'elle estime en danger : de l'universalisme des valeurs à la notion de progrès ou à l'idée que la raison est émancipatrice et non un instrument de domination comme le suggèrent ses détracteurs. Interview.

Il y a toujours un débat sur ce qu'est exactement le mot ‘woke’. Une définition courte pourrait être « la politique identitaire de gauche », c'est-à-dire la politisation des identités concrètes qui sont essentialisées.
Tout d'abord, je n'utilise pas le concept de politique identitaire. Je pense qu'il est erroné et que nous devons cesser de l'utiliser. Je parle plutôt de tribalisme. Mais ce n'est qu'un des problèmes de l'expression ‘woke’. Il y a deux autres problèmes pour lesquels je pense que le ‘woke’ se rapproche d'une vision réactionnaire et je les aborde dans le livre, à savoir la distinction entre la justice et le pouvoir et la question du progrès humain. Je pense que ces questions sont plus importantes que la question de l'identité, mais elles sont moins abordées. Deuxièmement, je ne pense pas qu'il soit possible de définir le ‘woke’, car il s'agit d'un concept incohérent. L'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre était de me l'expliquer. Le ‘woke’ est construit sur une base d'émotions très à gauche (être du côté des opprimés, redresser les torts du passé), avec lesquelles j'étais et je suis toujours d'accord. Le problème est que les émotions sont complètement séparées des idées. Et on utilise des idées très réactionnaires.
Il y a quelques décennies, essentialiser les gens (« les blancs sont comme ça », « les noirs sont comme ça », « les femmes sont comme ça ») était réactionnaire, mais aujourd'hui c'est progressiste. Vous citez Benjamin Zachariah : « L'auto-essentialisation et l'auto-stéréotypage ne sont pas seulement autorisés, ils sont considérés comme émancipatoires ».
Je pense que c'est lié à un sujet sur lequel je fais des recherches pour un autre livre. Nous sommes passés de l'identification au héros en tant que sujet de l'histoire à l'identification à la victime. Le héros est actif, personne n'est un héros simplement parce qu'il souffre. Mais au cours des soixante-dix dernières années, nous nous sommes concentrés sur la victime. C'est une correction, c'était une chose positive au départ. On a toujours dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et les victimes de l'histoire sont laissées de côté. Au milieu du 20e siècle, nous nous sommes rendu compte que beaucoup de gens étaient exclus de l'histoire. Certaines personnes ont commencé à penser qu'elles ne devaient pas rejeter leur statut de victime, et ont même découvert qu'il y avait des avantages matériels à s'identifier comme membre d'un groupe historiquement opprimé.
Que s'est-il passé au milieu du vingtième siècle pour provoquer ce changement, et est-ce une conséquence du mouvement anticolonial ou postcolonial ?
Je pense qu'il y a eu deux causes, l'une l'anticolonialisme et l'autre l'Holocauste, qui ont placé la victime au centre. Comme pour beaucoup de choses, les gens ont voulu corriger une erreur et une absence (le manque de victimes dans le récit historique), mais ils sont allés trop loin. L'Allemagne est un exemple de cette ‘sur-correction’ en ce qui concerne l'Holocauste.
Si l'on veut s'identifier à une victime, c'est parce que l'on attend une forme de réparation. Et cela ne peut se faire que dans une démocratie. Il ne viendrait à l'idée de personne d'exiger le statut de victime dans une dictature totalitaire.
C'est vrai, mais je pense que ce n'est pas un processus aussi conscient. Oui, certains individus se positionnent en tant que victimes afin d'obtenir des avantages, mais ce n'est pas le cas de la plupart d'entre eux. Par exemple, je déteste absolument être invitée à un événement ou à un comité uniquement parce qu'ils ont besoin d'une femme. Et je déteste que l'on m'identifie comme une ‘femme philosophe’. Je fais de la philosophie et mon sexe peut être important dans d'autres situations, mais il ne l'est pas dans ma profession. Et je pense que la plupart des gens ressentent cela d'une certaine manière, ils se sentent mal à l'aise lorsqu'il s'agit d'exploiter leur éventuelle position de victime. Mais même s'il ne s'agit pas de réparations monétaires, il y a une réparation symbolique : aujourd'hui, il semble que l'on ait plus d'autorité pour avoir été une victime. Le victimisme est devenu une source d'autorité. J'ai mentionné l'Allemagne tout à l'heure. J'ai beaucoup écrit à ce sujet. L'une des choses qui a changé mon point de vue a été de devenir un orateur de premier plan sur les questions de l'antisémitisme, d'Israël et de la Palestine, du point de vue d'un juif de gauche, ce qui est courant en Israël et aux États-Unis, mais très rare en Allemagne. Il y a très peu de Juifs de gauche. Et les rares qui osent s'exprimer contre Israël sont même traités de nazis. En Allemagne, il n'y a pas beaucoup de Juifs occupant des postes importants. Je dirige le Forum Einstein. J'ai remarqué que les voix les plus valorisées de la communauté juive en Allemagne sont celles des Juifs qui ne parlent que d'antisémitisme. C'est ce que font constamment les organisations juives officielles de droite. Et les Juifs qui ne veulent pas être considérés simplement comme des victimes possibles de l'Holocauste sont considérés comme moins authentiques. C'est un changement assez intéressant. Cela s'est également produit aux États-Unis avec le racisme. Les voix noires authentiques sont celles qui mettent l'accent sur l'histoire du racisme. Je lis beaucoup Franz Fanon, et dans l'un de ses essais, il dit : « Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui a déshumanisé mes ancêtres ». Et il dit beaucoup de choses similaires, qui sont choquantes aujourd'hui. Il est devenu un symbole de la théorie postcoloniale, qui est d'ailleurs très différente du mouvement anticolonial. Mais on ne considère pas souvent ces citations de Fanon, dans lesquelles il insiste encore et encore sur le fait qu'il ne veut pas être une victime, que ce n'est pas son identité.
C'est un débat similaire à celui d'un film récent, American fiction, dans lequel un écrivain noir fatigué des romans « authentiquement noirs » écrit une parodie qui finit par être un succès.
Je l'ai beaucoup aimé, mais je crois savoir que le livre de Percival Everett est bien plus que cela. Curieusement, si je n'avais pas vécu si longtemps en Allemagne, j'aurais vu le film et je l'aurais aimé aussi, mais j'aurais été plus nerveuse quant à ma propre position au sein de l'establishment culturel. J'aurais été plus inquiète. Mais maintenant que les Allemands m'ont traitée de nazi... je vois les choses d'un autre œil.
Votre livre, plutôt qu'une critique des ‘woke’, est une défense des Lumières.
Mon but dans ce livre n'était pas de définir les ‘woke’ mais de définir la gauche. Car je connais beaucoup de gens qui ne savent pas ce que signifie être de gauche aujourd'hui. Et je pense que c'est une catégorie qui a encore du sens. Il y a des gens qui se demandent, et je les comprends, pourquoi nous définissons encore les idéologies politiques en fonction de la répartition accidentelle des sièges au Parlement français en 1789. On peut s'interroger là-dessus, mais il y a une tradition que je revendique, qui commence au siècle des Lumières, et que je pense que nous avons perdue aujourd'hui. Il est vrai qu'il y a eu pendant longtemps de nombreuses critiques des Lumières ; au 20e siècle en particulier, Adorno et Horkheimer avec Dialectique des Lumières, un livre un peu décousu... J'ai été surprise que ce soit un livre qui ait autant plu à la gauche. Mais son importance s'est surtout manifestée en Allemagne à la fin des années 1960. La théorie postcoloniale a eu une portée plus large. La première fois que j'ai entendu une critique des Lumières, c'était avec le terme ‘euro centrique’, je me souviens exactement en 2006. J'écrivais un livre qui défendait les Lumières d'un autre point de vue. Cette critique me paraissait tellement stupide que je pensais qu'elle ne valait même pas la peine qu'on s'y attarde, qu'elle disparaîtrait rapidement. Car ce sont précisément les penseurs des Lumières qui ont été les premiers à mettre en garde vis-à-vis de la nécessité de voir le monde d'un point de vue non européen. J'avais tort. 2024 est l'année de Kant, le 300e anniversaire de sa naissance. Depuis le Forum Einstein, je réfléchis aux programmes et aux événements à organiser. De nombreuses institutions préparent quelque chose depuis des mois et des années, mais elles pensent toutes qu'elles doivent insister sur le fait que les Lumières étaient un projet colonial, que Kant était raciste. En Allemagne, elles se concentrent sur ce point. C'est l'image qui est transmise au public. Le problème, c'est qu'en écartant les Lumières, on perd beaucoup d'idées authentiquement de gauche. Et je pense qu'il était important de préserver ces valeurs et de critiquer l'idée que la raison est un instrument de domination, ce qu'on retrouve chez Adorno et Horkheimer, mais aussi chez Foucault, les penseurs postcoloniaux. Ils pensent que l'on peut se débarrasser de la raison, qui est un concept occidental, et se concentrer uniquement sur la ‘positionnalité’.
Carl Schmitt est un autre penseur analysé dans votre livre. Son attrait sur la gauche est surprenant, compte tenu de ses penchants nazis explicites. Vous dîtes une chose intéressante : « Schmitt suggère que les concepts universalistes tels que l'humanité sont des inventions juives [...] L'argument est dangereusement proche de la thèse contemporaine selon laquelle l'universalisme des Lumières déguise des intérêts européens particuliers ».
Kant est critiqué pour ses opinions racistes, mais on ignore que la pensée centrale de Schmitt est fondamentalement nazie. L'idée la plus célèbre de Schmitt est que les catégories fondamentales en politique sont, 'ami’ et ‘ennemi’. J'adore le fait qu'Adorno ait critiqué cette idée comme étant puérile, parce qu'elle l'est. La fascination de la gauche pour Schmitt est en partie liée à sa fascination pour la volonté politique, la politique sans limites, un certain autoritarisme. Mais je pense que ce qu'on aime vraiment, c'est sa critique de l'hypocrisie libérale. C'est l'idée que le libéralisme n'atteint pas vraiment ce qu'il cherche à atteindre. En particulier, sa critique de l'impérialisme britannique et américain. La gauche fait l'éloge de cette critique. Mais je ne comprends toujours pas cette fascination. J'ai organisé un symposium sur ce sujet, sur les raisons pour lesquelles la gauche est fascinée par Carl Schmitt. C'était très amusant, car les participants aux conférences n'avaient jamais été aussi nombreux. Les participants étaient des gens très respectables, presque tous allemands. Et ils ont tous montré leur fascination absolue pour Schmitt. Ils n'étaient pas capables de le critiquer. La prose de Schmitt est hypnotique, mais d'une manière différente de celle de Foucault ou de Judith Butler, qui est une prose dense, impossible, des penseurs qui brassent les eaux pour les faire paraître profondes. Schmitt a une capacité d'attraction différente, car sa prose est très simple. Il suffit de regarder sa thèse de l'ami et de l'ennemi, qui est étonnamment simple et presque enfantine, mais qu'il énonce avec une telle autorité. Toute son œuvre est ainsi, pleine de déclarations énergiques. Et l'on se dit que ce n'est pas si simple, qu'il doit y avoir quelque chose de plus compliqué derrière. C'est pourquoi je pense qu'il est considéré comme l'un des penseurs allemands les plus profonds.
Dans votre livre, vous faites une distinction intéressante entre l'optimisme et l'espoir. J'ai l'impression qu'aujourd'hui le pessimisme est de gauche (par exemple en ce qui concerne le changement climatique), alors qu'autrefois il était peut-être considéré comme réactionnaire.
Vous avez raison, mais ce n'est peut-être pas nouveau. Pensez au mouvement antinucléaire d'il y a quelques décennies, dans les années 1950 et 1960. La gauche se disait préoccupée par la destruction nucléaire. Je suis assez âgé pour me souvenir que de nombreuses personnes faisaient des cauchemars nucléaires, construisaient des abris et décidaient de ne pas avoir d'enfants de peur qu'ils naissent dans un monde inhabitable (ce que beaucoup disent aussi à propos du changement climatique). En même temps, je pense que ce n'était pas le même désespoir. Plusieurs facteurs expliquent ce plus grand désespoir de la gauche aujourd'hui. L'un d'entre eux est la fin du socialisme réel en 1991. Pour beaucoup de gens de gauche, après la chute de l'URSS, toute possibilité de mettre en œuvre une idée de justice sociale mondiale s'est évanouie. Pour les quelques personnes qui l'ont lu à l'époque, la Dialectique des Lumières d'Adorno et Horkheimer a également été très influente. Mais surtout Foucault : tout ce que l'on croit être un pas en avant et un progrès est en fait une forme de domination subtile. Et cela se répercute dans le débat public et dans les médias. On se moque de vous si vous parlez de progrès. Ils pensent que vous êtes naïfs ou que vous fermez les yeux sur l'injustice. C'est devenu une performance. Si vous voulez être considéré comme intelligent, vous ne pouvez pas parler d'espoir.
Vous dirigez le Forum Einstein, basé à Potsdam, et vous avez souvent écrit sur l'Allemagne et la manière dont elle gère son passé, sa position sur le conflit israélo-palestinien. La liberté d'expression est-elle restreinte lorsqu'on aborde ces questions ?
Pour la première fois de ma vie, je me censure lorsque je parle d'Israël en Allemagne. Même quelqu'un comme Thomas Friedman du New York Times est considéré comme radical. Je ne peux même pas citer ses textes sur Israël, qui sont plutôt modérés. Récemment, un événement sur les droits de l'homme a été annulé, par l'organisation elle-même, parce qu'elle ne pouvait pas en parler. Je suis préoccupé par la liberté d'expression, mais je suis surtout préoccupé par le fait que le débat est mal posé : êtes-vous plus préoccupé par la liberté d'expression ou par l'antisémitisme ? C'est un faux dilemme. La question est de savoir si ce qui est considéré comme de l'antisémitisme est réellement de l'antisémitisme. Souvent, ce n'est pas le cas. Nous avons assisté à une terrible augmentation de l'antisémitisme, mais c'est en partie à cause du comportement du gouvernement israélien. Et aussi parce que le gouvernement israélien et l'establishment juif conservateur ont transformé toute critique du gouvernement israélien en antisémitisme. C'est pourquoi les gens ont recours aux vieux clichés du genre ‘les Juifs contrôlent les médias’. Si j'étais ignorante, j'en arriverais à cette position, je comprends pourquoi les gens en arrivent à ces conclusions. Pendant longtemps, surtout depuis le gouvernement de Menachem Beguin, toute critique de l'État d'Israël a été qualifiée d'antisémite. Cette stratégie a été couronnée de succès. Et l'aile droite du monde entier, quel que soit son degré d'antisémitisme (d'Orbán à Trump en passant par Modi), a compris que le moyen de ne pas être étiqueté comme fasciste est de soutenir inconditionnellement le gouvernement israélien.
Voir, «El victimismo se ha convertido en una fuente de autoridad»







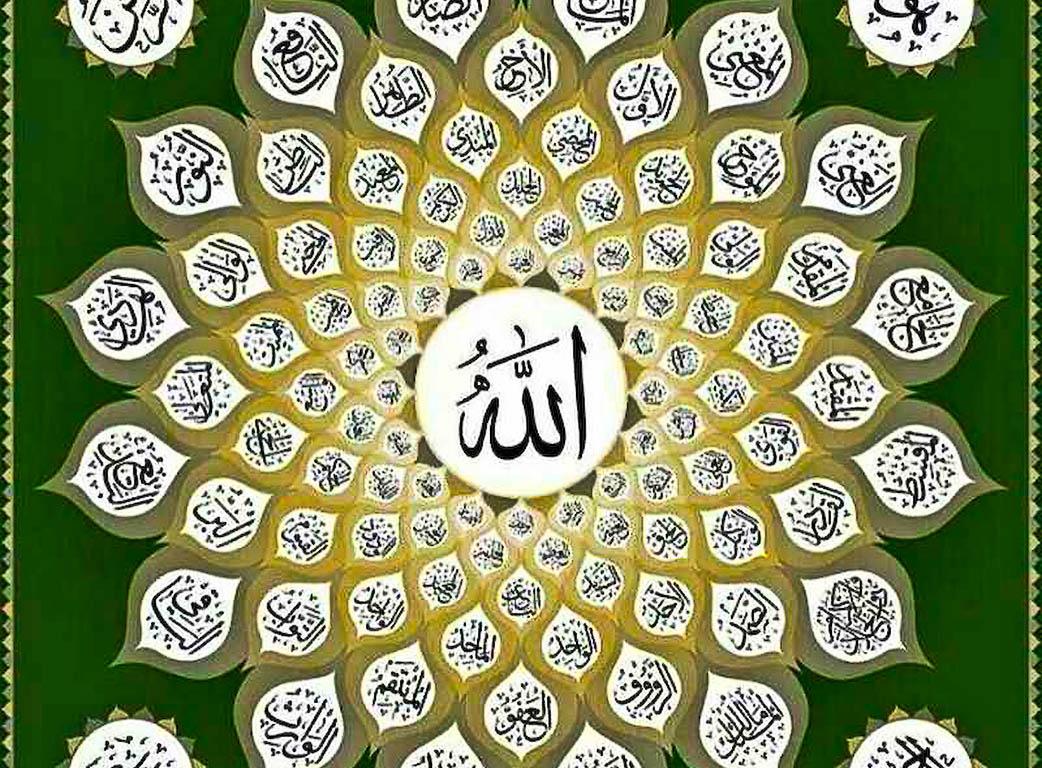













 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Laisser un commentaire